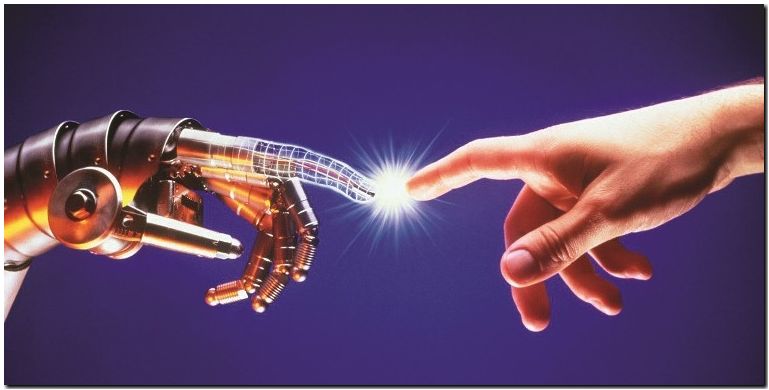Il aurait peut-être été judicieux d’exposer plus en détail le travail du groupe ethnotechnologie : cette approche est à mon sens le meilleur angle, et le plus simple, pour expliquer comment certains envisagent le transhumanisme, qu’on y adhère ou non.
Il est indéniable que les technologies influent sur les hommes, et donc sur les sociétés. Il serait malhonnête de le nier. La roue a permis à l’Homme de déplacer des matériaux et a favorisé paradoxalement sa sédentarisation. Beaucoup plus près de nous, Internet a modifié notre perception du monde, de nos voisins, de notre rapport à l’autorité. La téléphonie mobile a transformé notre manière d’interagir avec notre environnement.
Les technologies influent sur notre civilisation, à présent devenue globale. Certains diront que nous sommes devenus esclaves de ces technologies, d’autres les verront comme de formidables outils d’évolution. La technologie est ambivalente disait Jacques ELLUL. (in Le bluff technologique )..Qui maitrise qui?
Mais nous sommes loin de la globalité présentée par certains auteurs tels que Orwell la concevait dans 1984, où 3 super états se disputent la suprématie mondiale. Il est cependant intéressant de constater que certaines de ses prédictions n’étaient pourtant pas si farfelues : à notre époque Big Brother s’est invité dans nos foyers, avec notre consentement !
C’est là toute la difficulté de la prospective : il est impossible, à mon sens, de se défaire de son carcan contemporain : Orwell est un produit de la guerre froide, et ses extrapolations étaient forcément assujetties aux mécanismes de cette époque tout comme le film Gattaca (que je recommande) dénonce les dangers d’un eugénisme triomphant que personne ne remettrait en cause. Hors à l’heure actuelle, on s’aperçoit que chaque innovation, chaque changement majeur s’accompagne d’un débat et que les voix discordantes arrivent toujours aux oreilles du plus grand nombre : même avec maladresse, l’humanité se relève à chaque fois.
Les détracteurs du nucléaire ne prédisaient-ils pas une apocalypse imminente il y a de cela une cinquantaine d’années? Quid de Malthus qui n’a pas su anticiper les progrès de l’agriculture ?
Un auteur a érigé le transhumanisme en fil conducteur de son œuvre : Peter F. Hamilton ( voir : Hamilton Peter F. (1996), The Reality Dysfunction, London, Pan Books., etc. ). Sa vision me plait car elle nous laisse entrevoir une humanité en proie certes à ses démons, parfois victime de ses créations, mais qui a su maitriser ces effrayantes révolutions technologiques et en tirer quelque chose de positif.
On peut à l’opposé citer Barjavel et son roman Ravage qui nous met en garde contre notre foi aveugle dans les technologies.
Que l’on soit transhumaniste ou pas, la prospective est un exercice extrêmement difficile où trop de variables entrent en jeu. Le facteur humain est certainement le plus complexe à appréhender :
– Si je demande à une personne séro positive si elle se sent esclave de la trithérapie, je pense qu’elle me parlera de sa joie d’être en vie plutôt que des contraintes inhérentes à la prise du traitement.
– Si je demande à une nounou philippine si elle se sent esclave d’Internet car elle doit tous les soirs se mettre devant son écran pour voir ses enfants restés à des milliers de kilomètres, je pense qu’elle trouvera que le « sacrifice » en vaut la chandelle.
Quid des rayons X, des prothèses, des vaccins..?
Ranger la prospective dans le courant philosophique de l’ethnométhodologie me parait en ce sens réducteur.
L’enjeu est de savoir comment se répartissent ces outils, qui maitrise ces technologies : les puissants, qui les utilisent pour acquérir encore plus de richesses et assoir leur domination, ceux qui en récoltent les avantages sans les maitriser, et ceux qui subissent.